Critique : Le final de Dr. House
(Attention spoilers !)
C'est la fin ! C'est la fin... de l'une des plus grandes séries de l'Histoire ! L'occasion de revenir sur notre médecin misanthrope préféré, qui livre son dernier diagnostic.
Ce mardi 19 mars 2013, TF1 diffusait les deux derniers épisodes de Dr. House, le diagnosticien cynique qu'il est inutile de présenter. Débutée en 2004 et au travers de huit saisons, la série s'est révélée d'une incroyable qualité d'écriture et bouleversant le monde de la fiction hospitalière, qui, à part avec Urgences et Grey's Anatomy, n'a pas grand-chose pour vanter les mérites de nos médecins en blouse blanche. D'ailleurs, pas question ici de soap opera sur fond de blocs opératoires, car c'est le cas qui intéresse. Véritable génie de la médecine qui méprise ironiquement l'être humain et la vie, Gregory House est une sorte de Sherlock Holmes, qui traque et cherche à comprendre les patients atteints par les plus incroyables des maladies. D'où la forme singulière des épisodes qui alternent brillamment l'enquête (qui révèle souvent les coins les plus sombres des patients, questionnant perpétuellement le spectateur et les docteurs sur la condition de l'Homme) et la vie privée de notre bougon adoré, incarné avec brio par le désormais célèbre Hugh Laurie.
Si, avec le temps, la série s'est quelque peu répétée (réitérant sans cesse la même construction des diagnostics), c'est aussi pour pouvoir accentuer les relations de House avec son entourage, principalement composé de ses collègues, dont son meilleur (et seul) ami : Wilson. Cela n'a pourtant pas engendré un désintérêt des spectateurs (sauf aux États-Unis, où l'audience était en déclin) car House est loin d'être un homme parfait. Souffrant en permanence de sa jambe droite suite à une opération, il est obligé d'utiliser une canne et de se droguer à la Vicodin (un analgésique). Pensant que le monde s'acharne sur lui, notre médecin à l'intellect exceptionnel n'en est que plus moqueur, autodestructeur et excessif. Si ces défauts l'aident à sauver ses patients, ils ne font que l'enfoncer dans la solitude et le malheur, l'entraînant jusqu'en hôpital psychiatrique et en prison.
La question qui, de ce fait, taraudait tout le monde était : House doit-il mourir pour enfin être heureux ? Après tout, le départ (relié donc à la mort) a toujours été un sujet omniprésent dans la série. De la maladie incurable de Numéro 13 en passant par les démissions de Cuddy et de Chase ou encore le suicide inexpliqué de Kutner, elle touche en cette fin de saison Wilson, atteint d'un cancer (ironique pour un oncologue). Il prouve qu'il est définitivement la seule personne à laquelle House tienne réellement. Il en est même une sorte de double bon. L'un sans l'autre, ils ne sont rien. Alors qu'il ne lui reste que cinq mois à vivre, son ami boiteux se voit condamné pour une plaisanterie de trop responsable de quelques blessés à l'hôpital. Sa peine est suffisamment longue pour qu'il ne puisse pas accompagner Wilson dans ses derniers instants. Suspense haletant pour un final qui semble assez pessimiste. C'est alors qu'House se réveille dans un immeuble en feu aux côtés d'un cadavre. Ainsi débute « Everybody dies ».
Pour son dernier cas, les scénaristes ont eu la bonne idée de donner à House la plus retorde des énigmes : lui-même. L'occasion de le plonger dans son subconscient, faisant apparaître à ses yeux des morts (Kutner et Amber) comme des vivants (Cameron et Warner, l'ancienne compagne du médecin) qui vont tour à tour faire ressurgir les thèmes chères à la série : la religion, la souffrance, l'amour, la raison et...la mort ! House se retrouve dans un brillant combat avec lui-même dans un décor parfait pour sa situation. Si, d'habitude, les murs blancs ou colorés de l'hôpital, les blouses blanches et les lignes droites formées par les murs contrastaient avec cet homme au déplacement asymétrique toujours fringué d'un costard sombre, l'immeuble décrépi et abandonné embrassé par les flammes (qui se répandent jusqu'au plafond) reflète parfaitement son for intérieur et sa capacité d'autodestruction. Wilson et Foreman arrivent malheureusement trop tard. L'immeuble explose. House est mort ! Vive House !
Mais les scénaristes sont aussi malins que leur personnage, nous faisant presque oublier qu'il est maître dans l'art de la manipulation. Alors que tout le casting tient l'évidence à ses obsèques qu'il « savait aimer » (Wilson insistant tout de même sur le fait que c'était un « sale con ! »), on découvre que House a pu s'enfuir par la porte de derrière et a échangé les dossiers d'empreintes dentaires avec le macchabée retrouvé dans le bâtiment. Se prouvant à lui-même au bout de son diagnostic qu'il pouvait changer, l'ancien House est finalement mort et se permet une renaissance. Si cette fin peut décevoir les fanatiques du cynisme ambiant habituel, elle est en définitive dans la logique de la série. Le patient est guéri et va pouvoir continuer de vivre une belle vie, bien qu'elle amène toujours des souffrances. Se terminant sur un plan aérien de House et Wilson sur deux motos (symbole de liberté) au milieu d'arbres, ce final fait preuve d'un certain lyrisme et n'oublie pas de placer l'Homme, cette créature complexe, comme élément de la Nature. A travers son aspect politiquement incorrect, Dr. House est tout compte fait une série profondément humaine, qui se termine à l'image de son personnage : sans guimauve et discours inutiles. Si (comme moi), vous aviez tout de même la larme à l'œil à l'idée d'assister à la fin d'un voyage incroyable de presque dix ans, vous serez aussi pris d'effroi quand vous vous poserez la question : Qui pourra succéder à une œuvre aussi géniale ?
États-Unis (2004-2012)
Série crée par David Shore
Avec Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Jesse Spencer, Omar Eps, Peter Jacobson...
Chaîne d'origine : Fox





































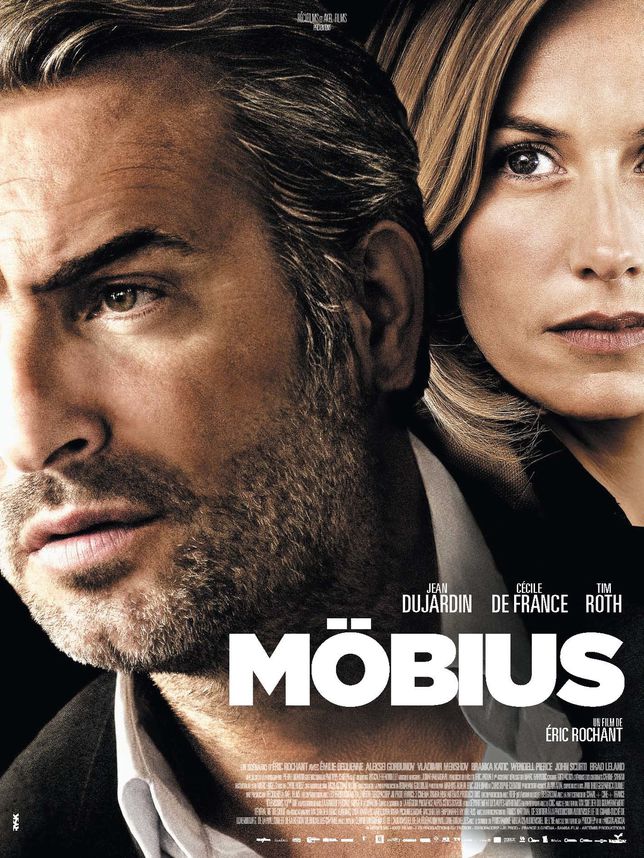







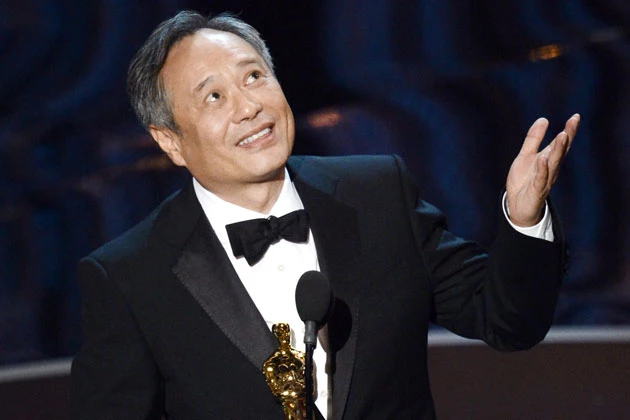








/image%2F0564477%2F201304%2Fob_55884f_429015-146538695498003-772116129-n.jpg)